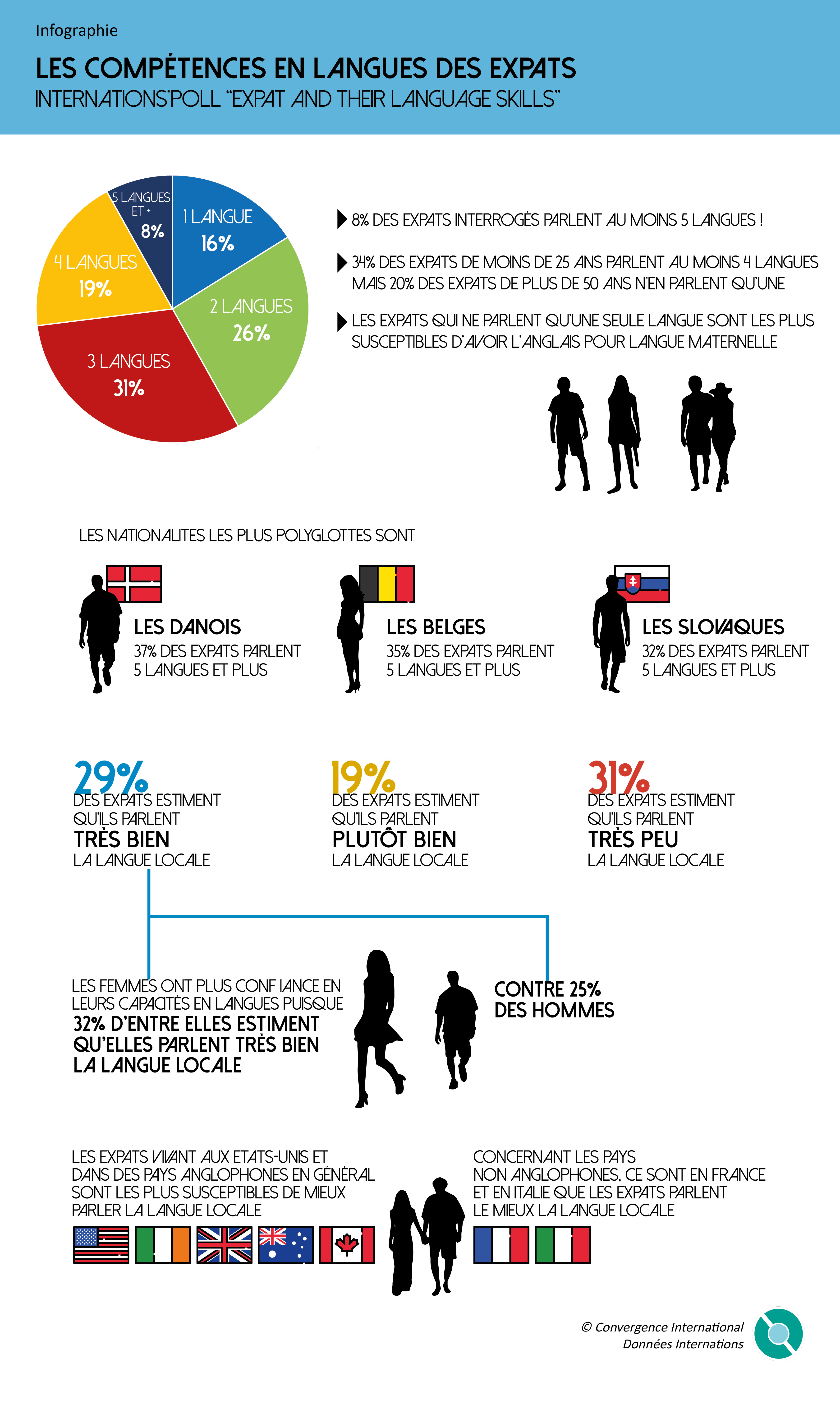La COP22 s’est achevée à Marrakech sur un consensus des Etats en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, les décisions concrètes sur l’application de l’Accord de Paris voté l’année dernière devront attendre 2018.
Finalement, la COP22 aura plus été une conférence de travail que de décisions concrètes. Les dispositions de l’Accord de Paris signé en 2015 pendant la COP21 visant à limiter le réchauffement moyen de la planète « bien au dessous de 2°C » par rapport au début de l’ère industrielle ne verront leur application discutée qu’en décembre 2018, lors de la COP24 polonaise. Entre temps, des négociations auront lieu par trois fois : à Bonn en mai prochain, puis lors de la COP23 en novembre 2017 et enfin en mai 2018.
La COP22 a guidé les Etats vers la mise en place de l’Accord de Paris à l’horizon 2018
La COP22 avait pour objectif principal de développer un manuel d’application pour l’Accord de Paris. Si la conférence de Marrakech n’a pas été aussi loin, les Etats se sont mis d’accord pour agir à partir de 2018, et non plus 2020. La communauté internationale développe une feuille de route pour respecter ce délai.
La COP24 devrait donc être l’étape de mise en place des plans climat nationaux pour 2020. Ce qui laisse deux ans aux Etats pour se doter de systèmes de mesure, de vérification et de transparence des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre dans chacun de leurs secteurs. Les vérifications auront ensuite lieu tous les 5 ans.
Les contributions nationales de réduction des émissions ont été confortées. Des pays puissants comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou encore le Mexique ont annoncé des plans ambitieux de réduction de 80 à 95% de leurs émissions à l’horizon 2050.
Un nouveau club, under2coalition, rassemble 165 pays adhérents derrière l’objectif de « zéro émission » d’ici 2050. 47 États, dont le Bangladesh et l’Éthiopie, se sont aussi engagés à essayer de limiter le réchauffement moyen à 1,5°C. Ils se sont réunis sous la bannière du « Climate Vulnerable Forum » et veulent atteindre l’objectif de 100% d’énergies renouvelables entre 2030 et 2050.
Si les divergences de points de vue n’ont pas disparues, les acquis de la COP21 sont tout de même confortés
Les pays riches, en particulier l’Europe, ont imposé leurs vues et vont prendre le temps de mettre en place leurs règles du jeu, au détriment des pays pauvres et vulnérables dans l’urgence. Plusieurs ONG ont dénoncé la mauvaise foi des représentants et négociateurs des pays développés quant à la question du déficit du financement à l’adaptation accordé aux pays les plus vulnérables aux effets du réchauffement.
10 milliards de dollars seront quand même débloqués d’ici 2020 pour déployer plus de 10 Gigawatts d’énergies renouvelables sur le continent africain. 200 projets d’initiatives locales sont également à l’étude, mais seuls quelques-uns seront retenus par la Banque africaine de développement et l’Union africaine pour bénéficier de financements. L’agence des énergies renouvelables, Irena, estime que l’Afrique aura un besoin énergétique d’au moins 300 GW d’ici 2030.
La déclaration finale de la COP22 réaffirme aussi l’engagement des pays développés à verser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à accéder aux technologies bas carbone et à adapter leur économie au changement climatique. Pour autant, les financements manquent encore. Les pays développés ont deux ans pour que cet objectif fasse partie de leur budget de manière pérenne.
Comme le note l’association Swiss Youth for Climate dans un éditorial publié par Swissinfo, « La COP22 fut finalement la COP de la pré-action, durant laquelle les pays ont, d’une part, rappelé l’importance fondamentale de l’engagement et de l’action climatique, notamment en adoptant la Proclamation de Marrakech, d’autre part, préparé, pas à pas, les processus fondamentaux à une mise en œuvre de l’Accord de Paris. Plus que jamais, la volonté politique est la clé. » Mais l’association s’inquiète de voir l’organisation de la COP24 attribuée à la Pologne dont les politiques environnementales « rétrogrades » pourraient freiner la dynamique qu’on avait vu naître lors de la COP21 d’un sentiment d’urgence climatique.