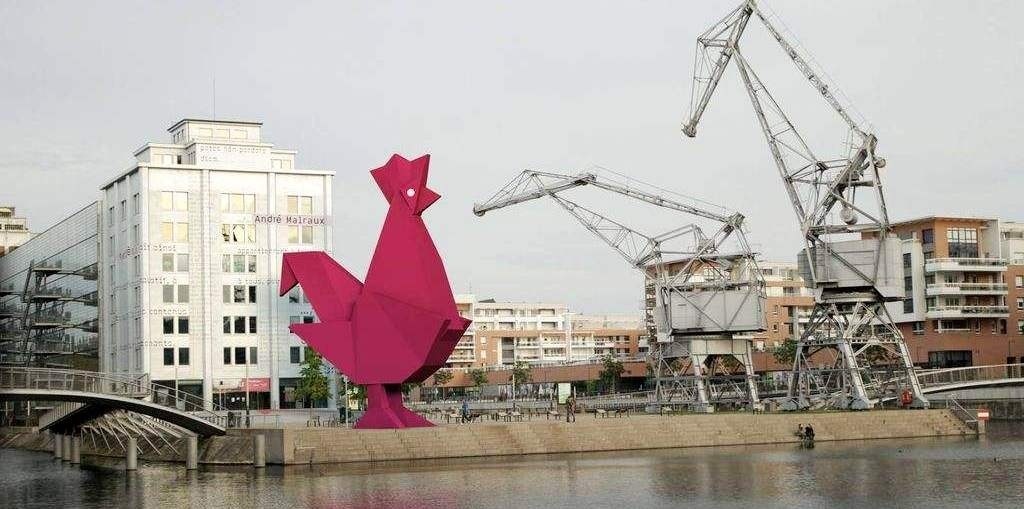Une vague de grèves et de contestations frappe actuellement la France sous couvert d’un rejet affirmé de la loi travail. Bien que celle-ci ait été largement modifiée par rapport au premier jet proposé par la ministre Mme El Khomri en février dernier, les contestations se sont poursuivies dans les rangs des syndicats et des étudiants. Le gouvernement a finalement décidé de recourir à l’article 49.3 de la Constitution, lequel permet l’adoption d’une loi en évitant qu’elle fasse la navette entre les deux chambres du Parlement.
Elle été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 12 mai dernier dans une version revue par le gouvernement en mars dernier puis modifiée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Nous allons voir ici les principales dispositions que la version finale devrait intégrer au code du travail.
Licenciement économique
Souvent attaquée sous prétexte de favoriser les patrons au détriment des salariés, la loi s’est vue modifiée suite aux contestations. Sa dernière version développe la notion de licenciement économique précisant qu’il ne peut faire suite à des « difficultés économiques crées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emploi ».
Un autre sujet de discorde concernait l’introduction d’un plafonnement des indemnités de licenciement pouvant être accordées aux prud’hommes : la dernière version de la loi travail ne fait mention que d’un barème indicatif et conserve le minimum (six mois de salaire) et l’indemnité légale déjà institués dans le code du travail.
Temps de travail
En ce qui concerne la durée de travail, le code du travail prévoit déjà un passage à une journée de douze heures au maximum selon un accord collectif ou de manière temporaire ainsi qu’un passage à une semaine de soixante heures au maximum en cas de « circonstances exceptionnelles » si la durée de travail hebdomadaire n’excède pas quarante-quatre heures sur douze semaines. Ces dispositions sont inchangées par la loi travail bien que légèrement assouplies.
Le travail de nuit est rallongé d’une heure et se termine non plus à six mais à sept heures du matin.
Pour les heures supplémentaires, celles-ci sont actuellement fixées par des accords de branche ayant tendance à favoriser les salariés et primant sur les accords d’entreprises. Mais la loi prévoit un inversement de ce rapport en faisant primer les accords d’entreprises, ce qui, d’après les opposants à la loi, permettrait aux employeurs de faire pression pour que la majoration des heures supplémentaires n’excède pas les 10%.
Congés
Concernant les congés, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a modifié la loi de manière à ce que les salariés puissent les prendre non plus après une certaine période de travail définie par l’employeur (« l’ouverture de [leurs] droit[s] ») mais dès leur embauche.
Deux jours de congés sont accordés aux pères de famille (et non plus seulement aux mères) pour enfant à charge compris dans les trente jours de congés annuels. Le nombre des congés pour événements familiaux inscrits dans l’actuel code du travail est désormais considéré comme un minimum susceptible d’être revu à la hausse par un accord d’entreprise ou de branche.
Négociations
La loi travail devrait rendre les négociations obligatoires entre syndicats et employeurs moins fréquentes. Dans le cas des accords collectifs, le seuil de représentativité des syndicats devrait être relevé de 30 à 50% ; si cette proportion n’est pas atteinte, un ou des syndicats représentant 30 à 50% des salariés pourront demander la tenue d’un référendum interne pendant un mois. Par ailleurs, les délégués syndicaux disposeront de 20% plus de temps pour exercer leurs fonctions, le temps horaire étant selon la taille de leur entreprise.
Contribution pour travailleur détaché
La loi travail instaure également une contribution pour les employeurs de travailleurs détachés. Celle-ci devrait permettre de limiter le recours à des travailleurs étrangers, travaillant sous droit français mais dont les cotisations sont pour l’instant reversées à leur pays d’origine.
Droit à la déconnexion
Une des grandes nouveautés de la loi travail qui a beaucoup fait parler à l’étranger est le « droit à la déconnexion », inexistant dans le code du travail actuel et qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier prochain dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il vise à réglementer l’utilisation des outils numériques pour garantir « le respect du temps de repos et de congés » des salariés. Pour le gouvernement français, il constitue une véritable avancée dans la prise en compte de la numérisation des conditions de travail.