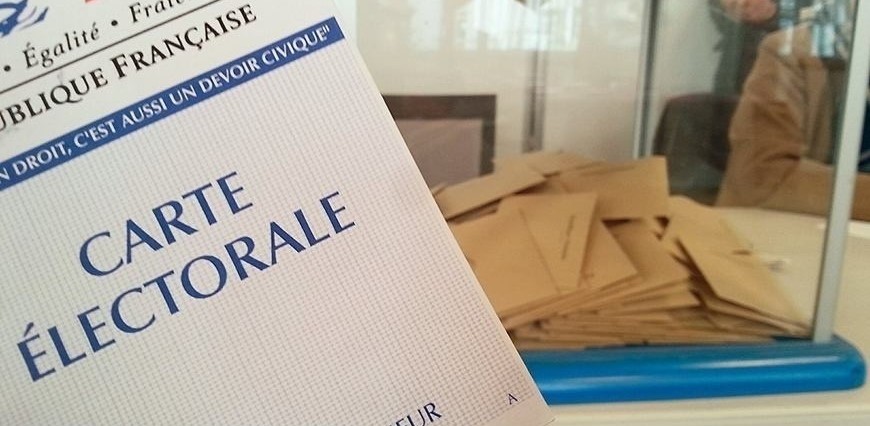Une classe moyenne plus optimiste, attachée aux marques et connectée est en train d’émerger en Afrique. En 2013, Deloitte estime qu’elle représentait 375 millions d’Africains, soit 34% de la population du continent. Et pourtant 60% de ces individus vivent avec 1,7 à 3,5€ par jour seulement ! Cette classe moyenne nourrit bien des convoitises pour les multinationales avides de conquérir un nouveau marché de consommateurs, mais encore faut-il bien la cerner.
Un marché de plus en plus attractif
La croissance de cette classe moyenne est largement tirée par les jeunes Africains : d’après Deloitte, d’ici 2030, le continent devrait compter 321 millions d’individus entre 15 et 24 ans. Et tous ces jeunes vont aspirer à plus de diversité en ce qui concerne les produits alimentaires, les produits de consommation et les loisirs qui leur sont proposés. Dans les pays où on constate la croissance la plus rapide tels que l’Egypte, le Maroc, le Nigeria ou encore le Cameroun, le jeunes sont plus optimistes que jamais quant à leur situation financière. Ces jeunes consommateurs seraient d’ailleurs plus sensibles à la qualité des produits qu’à leur coût malgré des revenus encore faibles pour la grande majorité d’entre eux.
L’urbanisation va également être un moteur du développement de cette classe moyenne. D’ailleurs, les zones urbaines africaines ont tendance à se développer au-delà des frontières nationales créant ainsi des marchés et des zones d’opportunités de taille considérable.
Le développement du continent pourrait être enrayé par certaines difficultés encore prégnantes : manque d’infrastructures, logistique peu fiable ou problèmes d’insécurité. Mais les besoins de consommation des Africains ont d’ors-et-déjà été pris en charge par la population : la croissance des technologies numériques mobiles a permis au continent africain de devenir le leader mondial du secteur de la vente en ligne.
Les controverses autour de l’émergence de la classe moyenne africaine
Un consensus général entoure le fait que l’Afrique serait devenue « la nouvelle Asie » et qu’elle aurait atteint l’âge de la consommation, ou en tout cas qu’elle le ferait très prochainement. On a rarement été aussi optimiste quant aux possibilités des investisseurs internationaux en Afrique. Et pourtant Nestlé a semé le doute en réduisant ses effectifs de 10% dans 21 des pays africains où le groupe est implanté sous couvert de la déclaration du directeur général Afrique équatoriale du groupe selon laquelle « la classe moyenne, dans la région, est extrêmement faible et ne croît pas vraiment ».
Il est vrai que même si on parle beaucoup des consommateurs africains, il est encore difficile de bien cerner leurs comportements, leurs goûts et leurs besoins. La Banque Africaine de Développement a établi que la majeure partie de la dite classe moyenne africaine ne vivrait qu’avec 2 à 4 $ par jour et formeraient ainsi une sorte de « floating class ». Or pour certains observateurs, cette floating class ne saurait être admise comme appartenant à une classe moyenne en ce que leurs comportements de consommation sont très restreints et que leur situation financière ne leur permet ni d’épargner, ni de financer de quelconques projets par le recours à l’emprunt bancaire.
Ipsos a réalisé une étude fondée non pas sur les ressources individuelles mais sur celles des ménages africains : l’institut français a ainsi dégagé deux groupes de ménages, entre ceux qui disposent de 12 à 25$ par jour et ceux qui en disposent de 25 à 50. Dès lors, la classe moyenne africaine ne serait plus établie à 34 mais à 13% de la population africaine, soit près de 143 millions de personnes. En tout cas, la Banque Mondiale confirme que la croissance économique du continent va soutenir l’essor de cette classe moyenne jusqu’à faire émerger une véritable société de consommation en Afrique.
Cela étant dit, quand bien les Africains ne forment pas encore de classe moyenne massive, le « bottom of the pyramid » peut tout à fait représenter une opportunité de développement pour les entreprises disposées à faire du business autrement. Cela suppose que les producteurs soient capables de vendre à faible coût des volumes importants afin de permettre aux populations encore lésées par la croissance de bénéficier d’un meilleur accès aux biens et aux services. De nombreuses études ont insisté sur le potentiel de consommation de la frange pauvre de la population en avançant notamment les exemples du marché mobile et d’Internet dont la croissance a été deux fois plus rapide en Afrique que dans le reste du monde.
Par ailleurs, cette classe moyenne n’est pas homogène sur l’ensemble du continent. Selon le pays on l’où se trouve, un même revenu ne donne pas accès au même panier de biens et les comportements des consommateurs ne sont pas non plus les mêmes. Effectivement, d’après Hélène Quénot-Suarez, « quelqu’un qui n’est pas sûr de la stabilité politique de son pays ne consomme pas de la même manière qu’une personne qui l’est. De même, un ménage qui n’a pas d’électricité tous les jours fait ses courses différemment de celui qui y a accès en permanence. Cela change les pratiques les plus basiques, comme la fréquence d’achat des produits frais ».
Une aubaine pour les entreprises francophones
La situation actuelle de l’Afrique témoigne du fait que le continent ne souffre pas d’une demande insuffisante mais plutôt d’une offre en berne. A ce titre, l’Afrique attire de plus en plus d’investisseurs, bien que ces derniers doivent s’adapter à un marché en pleine ébullition et qui a déjà ses propres codes.
Coca-Cola, Unilever ou Nestlé n’ont pas eu le succès escompté en s’implantant sur le continent, quelle leçon peut-on tirer ? Tout d’abord, toute est une question de dosage : les entreprises étrangères doivent prendre en compte des stratégies qui ont fait leur preuve sur de nouveaux marchés de consommation mais ne doivent pas négliger les particularités des marchés africains en proposant des modèles inédits. Rester fixés sur les caractéristiques des consommateurs indiens ou chinois n’est pas suffisant, il faut également s’inspirer des pratiques des producteurs locaux qui ont déjà cernés tous les tenants et aboutissants du marché où ils sont implantés. On peut retenir à ce titre le succès des entreprises télécom qui ont su adapter leur offre à l’Afrique notamment par le mobile banking.
Après avoir ouvert un centre commercial en décembre dernier, la Fnac devrait ouvrir son second magasin à Abidjan, en Côte d’Ivoire en février 2016. Le groupe français s’est pour cela appuyé sur le groupe local Prosuma (Société Ivoirienne de Promotion des Supermarchés). De nombreuses autres enseignes ont déjà jeté leur dévolu sur l’Afrique telles que Casino, Système U ou encore Carrefour, et d’autres sont encore amenées à le faire. Que ce soit dans le domaine de l’agro-alimentaire ou dans ceux des produits de luxe (L’Occitane) et du prêt-à-porter (Beaumanoir), les entreprises françaises ont saisi leurs avantages à s’implanter en Afrique et la tendance s’accélère. L’avantage dont dispose les investisseurs francophones est issu d’étroits liens historiques avec la région mais ils vont devoir faire attention à prendre position rapidement.